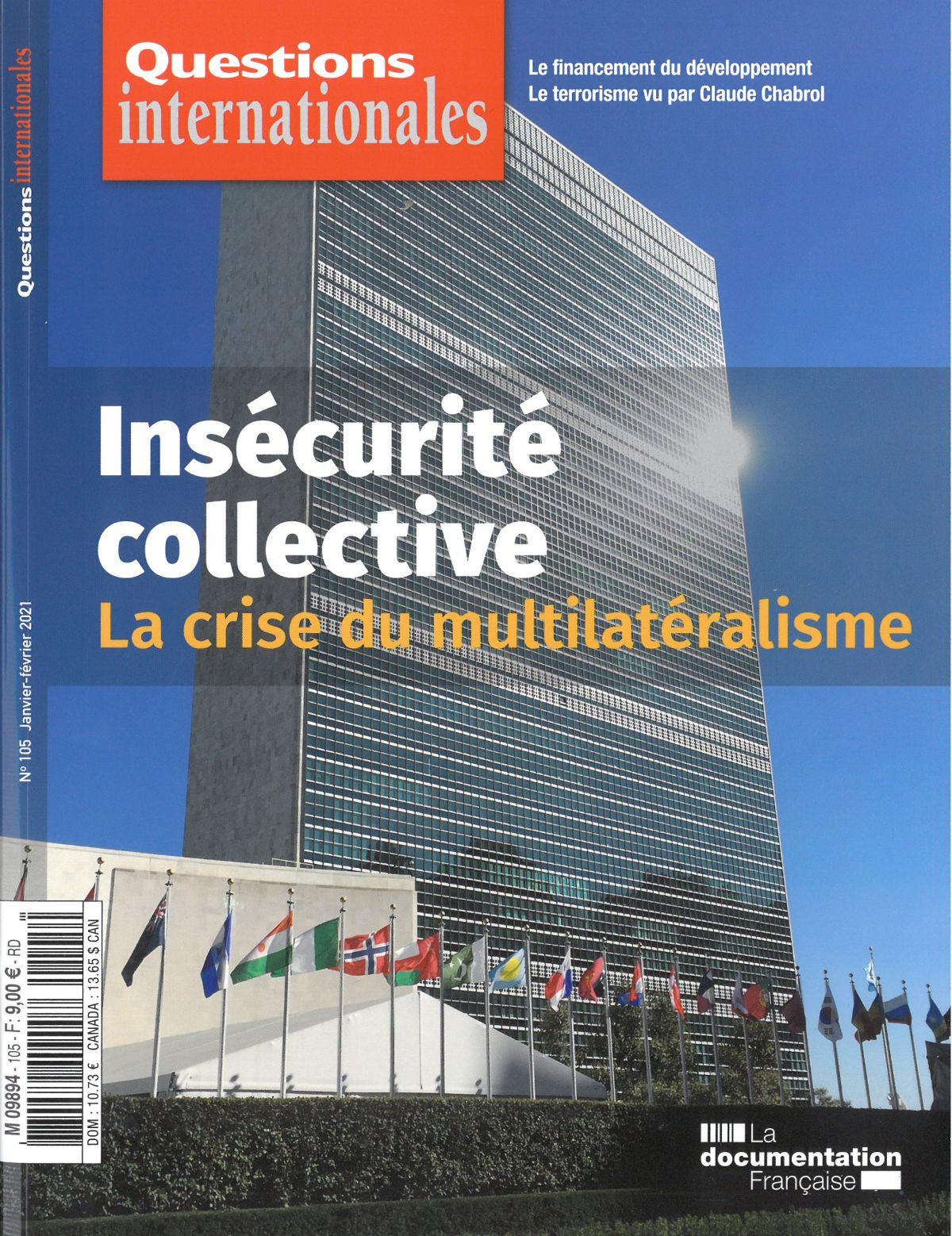Très ambitieux et créatif à la sortie de la guerre froide, affinant ses outils, le Conseil de sécurité a alors connu quelques succès mais aussi de nombreuses situations d’échec et des crises, notamment en Irak en 2003. La dernière décennie a marqué un recul continu de son rôle. Heureusement, dans ce triste tableau, le Conseil de sécurité a quand même reconduit le mandat de plusieurs missions de l’ONU, dont celle concernant le Mali, avec ses 12 000 casques bleus souvent à la peine. Plus de 75 ans après sa création, quel est son bilan et ses perspectives ?
Une grande ambition
Négociée en pleine Seconde Guerre mondiale, la principale ambition des fondateurs de l’ONU (États-Unis, URSS, Royaume-Uni) était vertigineuse : mettre en place, après la victoire, un système de sécurité collective efficace. Les membres de la nouvelle Organisation devaient s’engager à ne plus recourir à la force. En échange, ils auraient la garantie d’être défendus en cas d’attaque. Le Conseil de sécurité, composé de 11 États membres (15 depuis 1963) prenant ses décisions à une majorité qualifiée (9 voix aujourd’hui), serait chargé de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité ; la Charte lui en donnerait les moyens – mesures coercitives, recours à la force.
En offrant aux nations la garantie d’une paix future et durable, les trois grandes puissances encore en guerre contre l’Axe l’assortirent cependant de conditions. Alors que les autres États membres seraient élus pour deux ans, elles y siégeraient en permanence de même que la Chine et la France ; aucun texte, autre que de procédure, ne pourrait être adopté sans l’assentiment des "cinq". C’est le droit de veto. Il sera imposé sans ménagement par les futurs États membres permanents à la conférence de San Francisco créant l’ONU en 1945.
Ce privilège, critiqué dès l’origine par les États qui n’en disposaient pas, jugé souvent exorbitant, est indissociable du système. Sans lui, l’ONU et son Conseil de sécurité n’existeraient pas. Les grandes puissances, dont la contribution est indispensable pour garantir la paix, n’ont pas besoin de l’ONU pour assurer leur propre sécurité. Aujourd’hui, comme hier, elles n’accepteraient pas d’être soumises à une décision du Conseil contraire à leurs intérêts fondamentaux, dont elles veulent rester seules juges. Il s’agit d’une réalité incontournable.
Il en résulte que le Conseil de sécurité, même si l’on peut exprimer le vœu qu’il soit inspiré essentiellement par des objectifs de paix, même s’il est juste de rappeler le rôle des États membres non permanents souvent actifs dans le règlement de certaines crises régionales, est par essence un organe aristocratique dont les décisions, parfois l’inaction, dépendent de facteurs géopolitiques.
Il ne peut remplir sa mission que si les cinq États membres permanents coopèrent. Il peut alors faire preuve d’une grande audace, innover même. S’ils sont divisés, le Conseil se grippe et peut se bloquer. L’histoire depuis 75 ans en est la preuve.
Un bilan nuancé
Des hauts et des bas
Très vite, la guerre froide a paralysé le Conseil de sécurité. Dès 1947, la mise en place du dispositif de recours collectif à la force prévu par la Charte est renvoyée aux calendes. L’URSS, minoritaire, jugeant le Conseil défavorable à ses intérêts, bloque son action – une seule résolution adoptée en 1959 –, sauf dans des cas très particuliers (Congo, Chypre). À défaut de pouvoir régler ensemble les crises, les grandes puissances utilisent alors le Conseil comme une tribune accusatrice ou même une scène de théâtre – ainsi les États-Unis lors de la crise des missiles déployés à Cuba en 1962.
Ces 40 années de blocage cessent avec l’effondrement de l’URSS à la fin des années 1980. Commence alors une nouvelle période au cours de laquelle Moscou, pour essayer de contrôler la superpuissance américaine, accepte de donner vie au Conseil de sécurité. Washington, comme les États membres permanents européens, s’engouffrent dans la brèche.
Le P5
C’est ainsi que le P5 (le groupe des cinq États membres permanents) est né, favorisé par le secrétaire général Javier Perez de Cuellar, à la recherche d’un accord sur le cessez-le-feu dans la guerre Iran-Irak (résolution 598). Il atteindra son zénith en 1990-1991, lors de l’invasion du Koweït par Saddam Hussein. Pendant des mois, les permanents, sous la conduite des États-Unis, décident de tout (70 réunions) préalablement aux séances du Conseil qui se contente d’entériner.
Leur audace est remarquable : le Conseil de sécurité ne pouvant recourir au dispositif militaire prévu par la Charte, la décision est prise d’autoriser certains États à "utiliser tous les moyens nécessaires", c’est-à-dire la force, pour libérer le Koweït (résolution 678). Le précédent créé, cette formule, équivalent à une délégation de pouvoirs, sera utilisée ensuite à plusieurs reprises, y compris pour aider militairement des casques bleus – ainsi du soutien de l’OTAN à la mission de l’ONU en Bosnie en 1995.
Dans l’euphorie créée par cette réaction collective, le Conseil, sous influence occidentale, accepte dans la foulée l’idée que des violations massives des droits de l’homme puissent constituer une menace à la paix et la sécurité internationales, et se lance dans l’aide humanitaire. Il règle alors, avec le secrétaire général, des crises ou contribue à leur règlement, comme au Mozambique, en Namibie, au Salvador ou au Cambodge. Dix ans après la chute du bloc soviétique, il réagit encore avec une célérité remarquable à l’attaque terroriste du 11 septembre 2001, en légitimant la réaction à venir conduite par les Américains et en s’engageant dans la lutte contre le terrorisme.
Les résultats ne sont cependant pas toujours aussi probants. Dans les années 1990, il échoue en Somalie, au Rwanda et se fourvoie en Bosnie où son approche humanitaire, faute d’accord sur le fond, piège les casques bleus. À la fin de la décennie et au début des années 2000, les dissensions au sein du P5 sont de plus en plus difficiles à surmonter.
La crise irakienne de 2003
L’harmonie entre grandes puissances, sur laquelle reposait après la guerre froide la nouvelle gouvernance mondiale, était en effet fragile. Déjà mise à mal dans les affaires de l’ex-Yougoslavie, elle s’effrite progressivement à propos de l’Irak. Les cinq États membres permanents, dont le désaccord sur la durée et le périmètre des sanctions contre ce pays avait déjà créé des tensions, se déchirent lorsque George W. Bush décide d’un changement de régime par la force à Bagdad – et ce quel que soit le résultat de l’action des inspecteurs des Nations Unies revenus en Irak pour s’assurer de la destruction des armes de destruction massive (ADM).
La crise de 2003, au cours de laquelle la France, soutenue par la Russie, la Chine et la majorité des États membres non permanents du Conseil de sécurité, réussit à empêcher que ce dernier ne légitime la guerre décidée par Washington et Londres, est l’une des plus graves de son histoire.
Bien des cassandres prédirent alors la marginalisation du Conseil de sécurité. C’est pourtant l’inverse qui se produit ensuite car, assez vite, en 2004, les États-Unis et le Royaume-Uni ont besoin de l’ONU et donc de la coopération des autres permanents pour sortir politiquement du bourbier irakien où ils se sont engagés.
La crise irakienne passée, les réunions du P5 reprennent sur plusieurs sujets et une nouvelle période florissante s’ouvre donc pour le Conseil. Elle dure jusqu’à la fin de la décennie 2000, marquée par des décisions pour combattre le terrorisme – sanctions, obligations faites aux États de légiférer –, contrer la prolifération des armes de destruction massive – pressions sur la Corée du Nord, soutien et aval donné à l’accord avec l’Iran –, aider l’Afrique par de nouvelles opérations de maintien de la paix.
Les vicissitudes du droit humanitaire
Le Conseil devient aussi plus audacieux dans la prise en compte du respect des droits de l’homme comme facteur de paix, acceptant de nouvelles avancées pour la protection des civils. On oublie un peu aujourd’hui que les progrès dans ce domaine ne furent pas faciles à obtenir. Ils furent arrachés de haute lutte par les permanents européens à la Russie, à la Chine mais aussi aux États-Unis – le renvoi de la question du Darfour à la Cour pénale internationale par exemple – et parfois à des puissances émergentes.
Il n’est donc pas étonnant que certaines réserves soient réapparues à l’occasion de l’affaire libyenne. L’interprétation par les pays de l’OTAN de la résolution 1973 autorisant l’usage de la force, utilisée au-delà de la prévention des massacres pour favoriser un changement de régime en Libye, réveille en 2011 les partisans de la souveraineté sous la conduite de la Russie, qui profite de la polémique pour geler ensuite l’action du Conseil en Syrie.
Cette dernière crise marque un nouveau tournant. Sa gravité et sa durée créent des tensions entre États membres permanents mais aussi au sein du Conseil, que l’élection de Donald Trump et la confrontation entre Washington et Pékin vont encore aggraver. La décennie qui s’achève est finalement celle d’un grave recul de l’action du Conseil de sécurité (v. infra).
Le perfectionnement des outils
Souvent sollicité, parfois capable d’agir, le Conseil de sécurité a su progressivement améliorer ses méthodes de travail (réunions informelles), sa communication (déclarations à la presse) et s’ouvrir au dialogue avec le monde extérieur. Les États membres non permanents y ont parfois contribué (contacts avec la société civile). Surtout, il a su se doter d’outils et les perfectionner.
L’affinement des mesures coercitives
Outre sa capacité déjà évoquée d’innover dans la recherche d’une formule pour remplacer le dispositif d’utilisation de la force sous son autorité, prévu par la Charte, on retiendra aussi les progrès concernant les mesures coercitives de l’article 41 de la Charte, improprement appelées sanctions.
Les excès des embargos généraux, comme ce fut le cas contre l’Irak ou Haïti dans les années 1990, qui punissent les peuples plus que les régimes, ont rapidement conduit à des approches plus ciblées visant un ou plusieurs secteurs (armes, nucléaire, pétrole…), certaines activités (transport aérien…) ou des personnes (interdiction de voyager ou gel des avoirs des dirigeants). Un suivi assez soutenu a été mis en place, assuré par des comités des sanctions, organes subsidiaires du Conseil (14 actuellement) assistés d’experts.
Missions multidimensionnelles de paix
Enfin, il faut rappeler les opérations de paix conduites par le Secrétariat. Non prévues par la Charte, inventées par le secrétaire général avec la contribution de l’Assemblée générale lors de la crise de Suez en 1956, elles sont désormais décidées par le Conseil de sécurité. Celui-ci en fixe notamment le mandat, qu’il s’agisse de forces d’interposition, d’observation ou des missions multidimensionnelles de paix.
Ces dernières sont les plus complexes, les plus dangereuses, car l’ONU avec ses casques bleus, parfois en coopération avec les organisations régionales, doit accompagner la mise en œuvre d’accords politiques trop souvent fragiles (Mali) ou même en favoriser la négociation, stabiliser des situations, alors que la violence n’a pas disparu et que des acteurs locaux trouvent intérêt au maintien du désordre (République centrafricaine).
Les casques bleus sont au service d’un objectif ou d’un règlement de paix. Leur mandat les autorise parfois à utiliser la force, mais à des fins tactiques ou pour répondre à une situation humanitaire. Il est de bon ton de critiquer ces opérations. Elles le méritent parfois. Leur tâche est cependant difficile et leurs progrès constants, y compris actuellement – mandats plus robustes, qualité du matériel améliorée, meilleures formations et évaluations.
Une contribution à la paix et à la sécurité en recul
L’affaiblissement du Conseil de sécurité depuis dix ans, alors qu’il dispose d’outils plus performants, ne fait donc que souligner l’origine politique de la dégradation. Elle tient d’abord, nous l’avons vu, à la division des États membres permanents à propos de certaines crises.
Mais plus préoccupant encore, deux des États permanents – les États-Unis dans l’affirmation prioritaire de leurs intérêts entendus au sens large ; la Russie dans une défense absolue du concept de souveraineté sans égard pour les peuples – sont plus que jamais indifférents à la capacité d’agir du Conseil, à la cohérence de sa politique ou à sa crédibilité.
Dans ce contexte, bien des éléments sont inquiétants : la pratique du veto s’est à nouveau banalisée ; le Conseil n’est plus au centre du règlement des crises les plus importantes (Syrie) ; le soutien des membres permanents à leurs alliés régionaux, dont la rivalité attise les conflits, a pris le pas sur la recherche d’un règlement (Yémen) ; la lutte contre la prolifération est devenue secondaire dans l’agenda ; des textes de référence agréés sont bafoués – remise en cause par l’administration Trump des résolutions sur les territoires palestiniens occupés.
Les grandes puissances donnant le mauvais exemple, les dispositions de la Charte relatives à l’usage de la force mais aussi certaines mesures coercitives sont moins respectées. Dans ce contexte, les ambassadeurs débattent davantage qu’ils ne négocient, et le discours prend parfois un ton compassionnel plus propre à d’autres organes.
Vit-on un retour aux pires moments de l’histoire du Conseil ? Heureusement, le glissement n’est pas allé jusque-là. Le blocage n’est pas global. Le nombre de résolutions le prouve même si leur qualité baisse. La lutte contre le terrorisme unit encore les États membres permanents.
Le Conseil est par ailleurs capable d’un engagement continu concernant le règlement de crises non stratégiques pour les principales puissances, surtout lorsque sa contribution est sollicitée par les parties (Colombie) ou appuyée par une organisation régionale (Union africaine notamment). On peut ainsi affirmer que, sans l’ONU et son Conseil de sécurité, la stabilité serait plus difficile à assurer dans certaines zones sensibles (Sahara occidental, sud du Liban) et que les civils seraient encore moins protégés.
Le bilan de la décennie demeure malgré cela plutôt faible, très en deçà des périodes fastes. Sans compter que la dégradation s’est, année après année, accentuée.
Perspectives
Avec l’arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden en 2020, une évolution des États-Unis est intervenue sur deux dossiers importants de politique étrangère.
- Tout d’abord, le retour de Washington dans l’accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique a redonné un peu de souffle au multilatéralisme, bénéfique pour les Nations unies.
- La reprise des négociations sur le nucléaire iranien, même si elles restent difficiles, devrait avoir un impact sur le Conseil de sécurité avec le retour à l’entente entre les 5 États "dotés" de l’arme nucléaire sur ce dossier, et peut-être également des perspectives de travail pour le P5 dans le domaine de la non-prolifération et de la gestion de certaines crises au Moyen-Orient (Yémen).
La Chine a profité des excès de l’administration Trump et de son unilatéralisme pour marquer des points à l’ONU en essayant de rendre le système plus proche de sa vision du monde. Si l’administration Biden est désormais, dans certaines limites, plus favorable à l’organisation universelle, moins imprévisible, et davantage disposée à négocier au Conseil de sécurité, le cap donné à la politique de Washington à l’égard de Pékin ces dernières années ne change pas. La compétition entre les deux superpuissances est installée. Elle continuera à se manifester au Conseil de sécurité même si un dialogue minimum sur certains dossiers (Corée du Nord) n’est pas exclu.
Peut-on espérer une attitude plus ouverte de la Russie ? Un constat s’impose : si l’influence russe reste globalement faible dans le monde, sa capacité de nuisance est cependant grande ; ses succès dans la période récente au Moyen-Orient ont été acquis à un faible coût. Pourquoi, dans ces conditions, la diplomatie russe changerait-elle de ligne ? Il faut donc s’attendre à ce que, au cours des prochaines années, la Russie continue à se positionner au cas par cas, sortant du cadre de l’ONU lorsqu’elle y a intérêt, y compris par une présence militaire (Syrie), se prêtant au jeu diplomatique onusien lorsque cela l’arrange, recherchant l’appui de la Chine et des puissances émergentes (Inde, Brésil, etc.) sur la défense systématique du principe de souveraineté.
Ces tendances ne permettent pas d’augurer l’avenir du Conseil de sécurité avec beaucoup d’optimisme. Tout au plus peut-on espérer que cesse le glissement vers sa marginalisation et peut-être même entrevoir une amélioration de la situation.
Cet article est extrait de